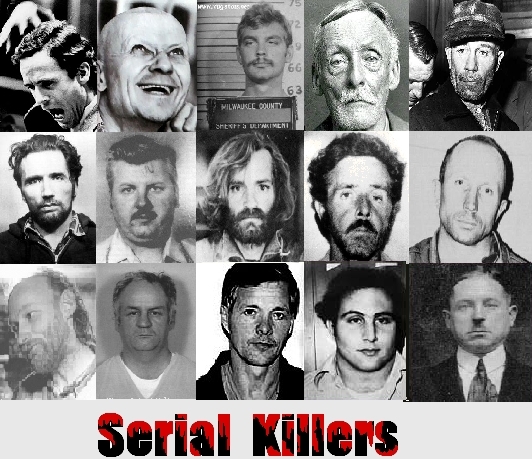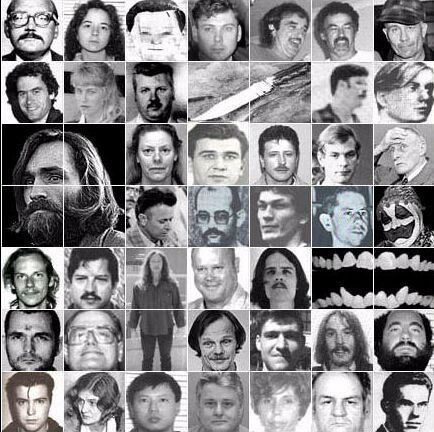2ème partie
Sur le carreau de la fosse n°3, le directeur de la Compagnie Lavaurs s'entretient avec le directeur des mines de Lens Reumaux, le directeur des mines de Dourges Robiaud, le directeur des mines de Meurchin Tacquet (qui avait été ingénieur à la fosse n° 3) ainsi que des ingénieurs des compagnies voisines. Sur le site, on peut apercevoir des médecins ainsi qu'une cinquantaine de gendarmes. Bar et Lecomte sortent du puits et vont voir le directeur Lavaurs. Ce qu'ils ont vu ressemble à un champ de bataille de 1870. Toutes les bowettes sont effondrées à 20 mètres de l'accrochage.
Un grand nombre d'ambulances, des voitures tirées par des chevaux arrivent sur les carreaux des fosses n°2, 3 et 4/11. Elles sont chargées de ballons d'oxygène, de gouttières, de médicaments, de matelas et de paquets d'ouate. Des salles ont été transformées en infirmeries, des baquets ont été remplis d'acide picrique. Des boissons chaudes ont été préparées par des femmes. L'explosion a eu lieu il y a trois heures. Seuls quelques hommes sont remontés. La foule prend peu à peu conscience de l'ampleur de la catastrophe à la vue de l'organisation des secours.
Les efforts ont été concentrés au puits n°4. Dirigé par l'ingénieur Dinoire, le mécanicien d'extraction parvient à rétablir le libre jeu de la cage. Vers 10 heures commence à courir un bruit. Le porion-contrôleur Payen aurait réussi à ramener à l'étage d'exploitation 300 une cinquantaine de mineurs qui travaillaient dans un quartier du n° 11. Parmi la foule aux abords de la fosse de Sallaumine, l'espoir de chaque personne est de retrouver un être cher. La cage remonte au jour. En trois voyages, 44 mineurs sont sauvés. Dans le lot, un des mineurs est gravement brûlé. Ses vêtements sont en lambeaux et son corps est presque nu. Il est immédiatement transporté à l'infirmerie où son corps est enveloppé de bandes de gaze jaunies d'acide picrique. La foule commence à s'agiter, les personnes présentes veulent à tout prix savoir qui sont les mineurs remontés. Au loin, tous les mineurs se ressemblent. Lorsqu'ils sortent du carreau de la fosse, ils sont tout de suite emmenés par les membres de leur famille chez eux.
C'est vers 10 h 30 qu'arrivent d'Arras le Préfet du Pas-de-Calais Duréault, l'ingénieur en chef du contrôle des mines Léon. Viennent ensuite des membres du parquet de Béthune. Le préfet interroge le chef-porion Douchy qui venait juste de remonter. Ce dernier vient de voir une douzaine de cadavres près de la recette (près du puits). À une vingtaine de mètres, les galeries sont éboulées, les bois tombés et les portes arrachées. Des coups sur des tuyaux ont été entendus par un autre sauveteur. Il reste donc des survivants dans les galeries. Hélas, en l'état actuel des choses, il est impossible d'aller les sauver : les sauveteurs s'évanouissent à cause des gaz qui envahissent les galeries, et la cage ne peut plus descendre en dessous de 300 mètres de profondeur car ses guides tordus la bloquent.

Sous la direction de l'ingénieur en chef Léon, les ingénieurs de l'État prennent en main les opérations de sauvetage conformément au règlement. Il reste à la fosse n°4/11 et envoie Leprince-Ringuet à la fosse n°3 et Heurteau au 10. Il est impossible de coordonner le sauvetage car la plupart des ingénieurs sont déjà occupés dans leurs puits respectifs et les galeries pour tenter de sauver les survivants.
Par la suite, la fosse n°10 devient le centre des secours étant donné que l'on peut accéder par les galeries aux puits n°2 et 3. C'est également dans cette fosse que l'équipe médicale venue de Lille opère. Les premiers cadavres commencent à être remontés. Deux cadavres couverts d'un linceul gisent sur deux lits de camps dans le bureau du chef de carreau. Les galeries accessibles sont sillonnées par des équipes de secours. Le maire de Billy-Montigny est interrogé alors qu'il allait rentrer chez lui. Il prévoit la mort de 1 200 mineurs et reste étonné qu'un coup de grisou ait ravagé trois fosses.
Pour accéder aux différents étages d'extraction de la fosse n°3, il faut tout d'abord déboucher le puits. Ingénieurs, mineurs et porions s'occupent à retirer le fatras de ferrailles tordues et de planches cassées. Certains scient les fers, d'autres cassent à la hache les planches. Le tout est remonté par le cuffat. Le déblaiement effectué, l'opération recommence quelques mètres en dessous. Vers 15 heures, la profondeur atteinte est de 55 mètres. En fin de journée, les mineurs ont atteint 170 mètres. Impossible d'aller plus loin, les débris forment un amas inextricable. Diverses solutions sont proposées. Le directeur des mines de Lens propose d'utiliser de la dynamite. D'autres proposent de laisser tomber un bloc de fonte dans le puits pour y précipiter au fond les débris. Petitjean n'est pas pour l'utilisation de la dynamite. Quant à Bar, il craint que le bloc dévie de sa chute et aille cogner contre les parois du cuvelage et que ces dernières ne cèdent. Ces nouveaux éboulements risqueraient de réduire la section d'aérage. De plus, il faudrait encore pouvoir avertir les éventuels rescapés de s'éloigner du puits au moment de la chute. L'ingénieur Léon décida de surseoir la décision. Toutefois, tout est prêt dans l'éventualité où un choix serait nécessaire.
À la fosse n°4/11, les ventilateurs marchent à fond. L'air devient plus respirable dans le puits, toutefois, il reste impossible pour la cage de descendre au-delà de 300 mètres. L'idéal serait de remplacer la cage par une plus petite mais cette opération prendrait plus d'une heure. Ce délai est trop long, des hommes meurent au fond[2]. À cette heure, un bilan est dressé pour cette fosse : 852 descentes ont été enregistrées au matin. 47 hommes ont déjà été sauvés, et 125 mineurs furent miraculés. L'ingénieur avait fait remonter 125 personnes étant donné qu'ils n'avaient pas pu arriver à leurs tailles d'exploitation proches de l'incendie, quelques minutes avant la catastrophe. 680 mineurs manquent donc à l'appel. Des mineurs descendent sous la cage afin de scier les guides. Après une heure d'efforts, la cage peut passer. Un spectacle de désolation attend l'équipe de sauvetage lorsqu'elle atteint le dernier accrochage : des blessés souffrent atrocement au milieu des cadavres déchiquetés. Pendant que certains sauveteurs font remonter au jour les blessés, d'autres explorent les bowettes. Les galeries sont remplies de mauvais air, d'éboulements et de cadavres.
Certains sauveteurs commencent à se sentir asphyxiés. Près de l'accrochage, Dinoire et Lafitte tombent. Quatorze cadavres sont remontés sur le carreau. La foule est anxieuse. Des ambulances arrivent. Des blessés ont donc été remontés mais ils sont dans un sale état. Ils sont presques nus, leur peau se détache par lambeaux. L'un d'eux est même scalpé. Ils sont transportés à la lampisterie sur des civières. Ils sont pansés. Ils sont ensuite mis dans les ambulances. La grille s'ouvre, la foule arrête l'ambulance, des hommes montent à bord pour demander au blessé son nom. Ce nom est ensuite crié à la foule. On a ainsi Pierre Devos de Sallaumines, son bras droit est arraché. Viennent ensuite trois grands brûlés Eugène Choisy, cabaretier à Pont de Sallaumines, Gaspard Guilleman de Méricourt-Village et Jean-Baptiste Lemal de Méricourt-Corons. Certains blessés, aidés de leurs camarades, rentrent à pied dans leur coron. Les familles des mineurs veulent avoir des nouvelles des leurs.
Les sauveteurs se reposent un peu sur le carreau. Ils pensent avoir entendu des appels mais l'air demeure irrespirable au fond. Un journaliste demande s'il reste encore des blessés. Un sauveteur lui répond que c'est fini. Tous les survivants ont été remontés, il ne reste plus que des morts. L'ingénieur Dinoire confirme.
À 14 et 19 heures, les sauveteurs réussirent à entendre des appels provenant du fond du puits.
À 22 heures, une équipe d'ingénieurs des Mines de l'État arrive. Elle prend désormais en main la conduite des opérations de sauvetages. Estimant que les conditions minimales de sécurité n'étaient pas remplies, ils ordonnèrent l'arrêt immédiat d'une descente plus profonde avant que ne soit consolidé le puits n°3. Les sauveteurs étaient pourtant parvenus à 160 mètres de profondeur.
Le 11 mars, à 22 heures, la profondeur de 180 mètres est atteinte. On donna l'ordre de stopper définitivement les travaux de sauvetage. Un bilan du sauvetage des fosses n°2 et 4 est dressé : après deux jours et deux nuits d'efforts, on ramena 25 survivants et 43 cadavres. Quelques sauveteurs disparurent pendant ce sauvetage.

Dans la journée du 11 mars, l'ingénieur en chef a voulu réunir une table ronde et interroger les survivants. Le but était de faire un point précis sur la situation. En revanche, les ingénieurs et les mineurs ne voulaient pas perdre de temps en bavardages pendant que leurs camarades mouraient au fond. Cette opposition eut sa part de responsabilité dans l'ampleur des pertes humaines car les ingénieurs envoyés par l'État, piqués dans leur orgueil, adoptèrent des mesures qui furent parfois aberrantes. Ils considéraient qu'il n'était pas possible de désobstruer le puits n°3, dont le cuvelage et les installations étaient fortement abimés à la profondeur de 160 mètres. De plus, toutes les recherches qui avaient été menées à partir des puits n°2 et 4 démontraient qu'il ne restait aucun survivant dans les quartiers du n°3, les ingénieurs de l'État décidèrent de fermer le puits n°3, d'actionner les ventilateurs afin de le transformer en puits de sortie d'air. La polémique vient du fait que le grand nombre de victimes soit dû en grande partie à l'obstination de la compagnie minière à poursuivre l'exploitation dans les autres puits alors qu'au fond un incendie n'avait pas encore été complètement maîtrisé et que des fumées et gaz toxiques remplissaient encore les galeries. Mais il y aurait aussi eu probablement moins de morts si les recherches n'avaient pas été arrêtées dès le troisième jour et si une partie de la mine n'avait pas été murée, sur ordre de l'ingénieur général Delafond, pour étouffer l'incendie et préserver le gisement.
La gestion de la crise par la compagnie minière fut particulièrement mal vécue par les mineurs et par leurs familles. La compagnie fut accusée d'avoir fait passer la sécurité des mineurs après la protection des infrastructures en particulier en prenant la décision de murer les galeries et d'inverser l'aérage pour extraire la fumée et étouffer l'incendie au lieu de faciliter le travail des sauveteurs en leur envoyant de l'air frais. De plus, les trois premiers jours, les corps extraits de la mine ne furent pas présentés aux familles pour identification. Quand celle-ci devint possible, elle ne fut ouverte qu’un seul jour : les familles durent ainsi passer en une journée devant les mille corps pour identifier leurs proches. Aucun responsable de la mine, ni aucun fonctionnaire ne donna non plus d’informations aux familles. Enfin, les veuves furent chassées des corons
Le 12 mars, à une heure du matin, le plan est mis en œuvre, les orifices du puits sont fermés et les ventilateurs du puits n°3 sont redémarrés pour en faire sortir l'air. À l'inverse, les ventilateurs sont stoppés sur les puits n°2 et 4. Ils deviennent ainsi des entrées d'air. Le puits n°4 est fermé.
À 9 heures, Une équipe de mineurs allemands volontaires arrive pour aider dans les secours : ils étaient équipés de masques à oxygène, éléments que ne possédaient pas les sauveteurs français. Lorsque les sauveteurs allemands arrivèrent, les recherches étaient déjà abandonnées. De plus, ils furent accueillis avec hostilité alors que se déroulait la crise franco-allemande au Maroc.
Le lendemain, c'est sous une tempête de neige que se déroulent les obsèques officielles. À cause des flammes, un grand nombre de mineurs ne pourront jamais être identifiés. Pour éviter les épidémies, les corps sont ensevelis dans une fosse commune, appelée le silo. La cérémonie se déroule à la va-vite ce qui provoque colère et amertume chez les familles. L'ingénieur en chef et le directeur de la compagnie furent tellement hués par la foule qu'ils durent quitter le cimetière.


Le 14 mars, un nouveau bilan est établi : on dénombre 429 morts à la fosse n°3, 506 morts à la fosse n°4 et 162 morts à la fosse n°2
Le 15 mars, les sauveteurs doivent se décider à stopper les recherches à cause d'un incendie qui s'est déclenché dans les galeries. Ils ne trouvèrent que des cadavres ce jour-là.
La colère puis la révolte montèrent dans le bassin minier. Les mineurs se mirent en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. 40 000 ouvriers étaient dénombrés dans ce mouvement à la fin du mois de mars. La visite effectuée par le ministre de l'intérieur Georges Clemenceau et l'arrivée de 20 000 militaires n'ont pas réussi à calmer la situation, bien au contraire.
On commença à se demander si les ingénieurs de l'État n'avaient pas fait une erreur en considérant qu'il n'y avait plus de survivants au fond seulement trois jours après la catastrophe. D'autres rescapés auraient peut être pu être retrouvés. Jean Jaurès, dans L'Humanité, alla jusqu'à poser cette question : "Et serait-il vrai que, par une funeste erreur, ceux qui dirigeaient les sauvetages, croyant qu'il n'y avait plus en effet d'existence humaine à sauver, se sont préoccupés plus de la mine que des hommes ?"
Le 30 mars, soit vingt jours après l'explosion, treize rescapés réussirent à retrouver le puits par leurs propres moyens après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. Ils furent aperçus par un ouvrier sauveteur à proximité de l'accrochage dans le puits n° 2. Une équipe descendit et trouva 13 hommes faisant des gestes désespérés dans l'obscurité. Les mineurs ont raconté avoir mangé le peu qu'ils trouvaient, y compris de l'avoine et un cheval qu'ils ont abattu à coups de pic.
Les treize rescapés sont Léon Boursier (19 ans), Louis Castel (22 ans), Honoré Couplet (20 ans), César Danglot (27 ans), Albert Dubois (17 ans), Élie Lefebvre (38 ans), Victor Martin (14 ans), Henri Neny (39 ans), Romain Noiret (33 ans), Charles Pruvost (40 ans) et son fils Anselme Pruvost (15 ans), Vanoudenhove Léon (18 ans) et Henri Wattiez (27 ans)
Berton, le dernier survivant.Le dernier survivant des treize rescapés de la catastrophe était Honoré Couplet. Il est décédé en 1977 à l'âge de 91 ans. Parmi les rescapés deux d'entre eux continuèrent à travailler à la mine durant quarante-deux et quarante-cinq ans, étant donné que c'était leur seul gagne-pain.

Un quatorzième survivant, Auguste Berton, mineur à la fosse n° 4 de Sallaumines, fut retrouvé le 4 avril, grâce aux secouristes allemands qui avaient apporté des appareils respiratoires qui faisaient cruellement défaut aux compagnies minières locales. Il avait erré durant 24 jours à plus de 300 mètres de profondeur, dans le noir complet et les fumées toxiques. Il fut remonté par le puits n° 4.
L'émotion qui s'ensuivit, et la polémique sur la gestion des secours, sont à l'origine d'un vaste mouvement de grève. Le 13 mars, lors des obsèques des premières victimes, à la fosse commune de Billy-Montigny, sous une tempête de neige, en présence de 15 000 personnes, le directeur de la compagnie est accueilli par des huées et des « assassins ! » et doit rapidement partir ; la foule scande « Vive la révolution ! Vive la grève ! ». Le lendemain, les mineurs refusent de redescendre au fond. Les syndicats appellent à une grève qui s'étend aux puits environnants. Le mouvement s'étend à tous les bassins miniers français et se développe jusque dans le Borinage, en Belgique. Le 16 mars, 25 000 ouvriers sont en grève, chiffre qui monte même à 60 000. Les incidents se multiplient entre grévistes et non-grévistes, mais aussi entre les partisans du "Vieux Syndicat" mené par Émile Basly et le "Jeune Syndicat", affilié à la CGT et mené par Benoît Broutchoux. Face aux mineurs en colère, Georges Clemenceau, alors Ministre de l'Intérieur, mobilise 30 000 gendarmes et soldats et envoie treize trains de renforts militaires . De nombreuses arrestations ont eu lieu.

La colère des mineurs est renforcée par la découverte tardive de rescapés. Les secours ont manifestement été abandonnés trop tôt et la Compagnie de Courrières est accusée de vouloir enterrer vivantes les victimes. La grève se durcit et un officier de l'armée est tué le 23 avril. À la fin du mois, malgré la répression et le manque d'argent des familles des mineurs, le patronat concède des augmentations de salaires. Le travail reprend début mai.
Cette catastrophe a suscité un élan de générosité sans précédent en France et en Europe et 6,5 millions de francs-or sont collectés. La compagnie minière elle-même donne 2,2 millions de francs aux ayants droit et verse des rentes annuelles de l'ordre de 500 000 francs aux familles.
La catastrophe provoqua une crise politique et un mouvement social qui déboucha sur l'instauration du repos hebdomadaire .
Après la catastrophe, la langue française s'est enrichie d'un mot nouveau d'origine picarde : rescapé, largement repris dans la presse, et qui supplanta réchappé.
À la suite d'une catastrophe d'une telle ampleur, une légitime exigence de « plus jamais ça » s'est imposée. Des études ont donc été conduites pour analyser ce qui s'était passé et mettre au point des méthodes permettant de diminuer le risque, et, plus encore, sa gravité.
L'analyse a montré que trois facteurs avaient causé la catastrophe. Le premier est un « coup de grisou », l'explosion d'une masse d'air mélangée de grisou, gaz naturel associé au charbon et essentiellement composé de méthane. Ce gaz est dissous dans le charbon et les roches encaissantes (des schistes et des grès), mais s'en échappe du fait que la pression est bien moindre dans l'air des galeries que dans les roches. La fracturation des roches, naturelle ou induite par le foudroyage, facilite ce dégazage. Le deuxième facteur est l'inflammabilité des poussières de charbon. Le souffle brûlant du coup de grisou les met en suspension dans l'air et les consume instantanément, ce qui renforce l'explosion qui peut ainsi se propager, littéralement comme une trainée de poudre. C'est le « coup de poussier ». Le troisième facteur est l'absence d'obstacle qui pourrait empêcher l'explosion de se propager indéfiniment dans les galeries et les puits.
Depuis bien longtemps, le risque de coup de grisou est prévenu par une aération suffisamment importante pour que la teneur du grisou dans l'air n'atteigne jamais les teneurs dangereuses de 6 à 12%. Cette précaution n'est pas infaillible car le débit des émanations de grisou peut varier de manière imprévisible. Le risque de coup de poussier est difficile à prévenir car la poussière de charbon est omniprésente dans la mine, et parce que l'aération, qui dilue et emporte le grisou, dessèche aussi ces poussières. Les parades sont, d'une part l'arrosage, et d'autre part l'ajout à la poussière de charbon de poussière ininflammable, comme la poussière de roche. L'énormité de la catastrophe de Courrières s'explique par la propagation indéfinie de l'explosion, 110 km de galeries ravagées, rappelons-le. Ce risque ne faisait alors l'objet d'aucune prévention. Les études menées ensuite portèrent donc notamment sur cet aspect, et aboutirent aux arrêts barrages, ou taffanels, du nom de leur inventeur Jacques Taffanel. Ces arrêts barrages consistent en une sorte de faux plafond en planches sur lequel sont posés des auges remplies d'eau, de plâtre ou de poussières ininfammables, et sont généralement associés à une cloison bouchant la galerie, une porte normalement fermée permettant néanmoins le passage. Le but de cette cloison n'est pas d'arrêter un éventuel coup de poussier, mais plutôt de concentrer son souffle sur les auges pour en disperser le contenu dans un grand volume d'air qui, lui, fera bouchon en privant l'explosion de nouveau combustible. Disposés le long des galeries, ces dispositifs se sont révélés efficaces, puisqu'aucune catastrophe n'a atteint depuis, et de loin, l'ampleur de celle de Courrières.
À partir de cette époque, les lampes à feu nu sont bannies au profit des lampes dites de sûreté (lampes Davy). En 1907, le premier poste central de secours du bassin Nord-Pas-de-Calais est créé à Liévin (il sera transféré à Éleu-dit-Leauwette après sa destruction pendant la Première Guerre mondiale). On y forme des équipes spécialisées de sauveteurs et on y étudie les risques dus au grisou et aux poussières. En 1910, apparait le marteau-piqueur qui augmente le rendement, mais aussi la quantité de poussières, avec les risques d'explosion et de maladie (silicose) qui en découlent...