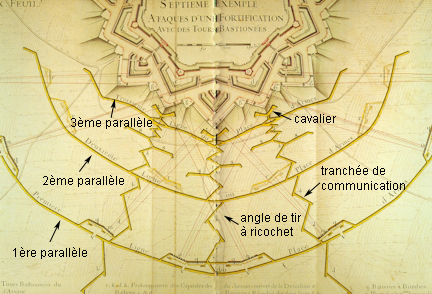Re: PERSONNAGES ET FAITS HISTORIQUES DE FRANCE (philatélie)
Publié : mer. déc. 29, 2010 3:02 am
Étienne-François de Choiseul, comte de Stainville puis duc de Choiseul, né le 28 juin 1719 à Nancy en Lorraine et mort le 8 mai 1785 à Chanteloup, ambassadeur puis secrétaire d'État de Louis XV.
Issu d’une grande famille originaire de Lorraine, il porte – comme son père – le prénom du dernier duc de Lorraine et de Bar, François III Étienne.
Fils aîné de François Joseph de Choiseul, marquis de Stainville (1700-1770), et de Françoise-Louise de Bassompierre, il prend d’abord le titre de son père lequel l’envoie faire carrière en France tandis que son cadet est destiné à servir l’Empire (le duc François III Étienne étant destiné à succéder à son beau-père l’Empereur Charles VI).
Il s’engage dans l’armée dans le régiment de Navarre, avec lequel il participe aux campagnes de Bohême en 1741 et d’Italie, notamment la bataille de Coni, pendant la guerre de Succession d'Autriche.
Choiseul possède à la fois des capacités aux affaires et de l’assiduité au travail, mais il manque de ténacité contre ses opposants. Physiquement il était petit et laid.
« Léger et frivole dans son privé jusqu’à l’effronterie, roué dans l’intrigue jusqu’au cynisme, il joignait aux grandes capacités de l’homme d’État le rayonnement d’un chef de parti, et de ce double fait il a dominé la vie politique de son temps ».
Son amoralisme dans les affaires de l’amour et du pouvoir – inextricablement enchevêtrées au long de sa carrière – ne l’empêchait pas d’avoir, à la différence de plusieurs de ses rivaux, une conception sérieuse et personnelle des tâches politiques.
Laïc et libéral – admirateur du système britannique – Bien qu'il ait souvent été considéré injustement comme n'ayant jamais eu le projet de réformer l’État (confère les Mémoires de Talleyrand). la réalité est plus complexe. Pour un homme d'Etat libéral, il est à l'origine de la modernisation des appareils de souveraineté tels que l'armée, la marine, la diplomatie afin de préparer la revanche contre l’Angleterre. De ce fait il a contribué de manière indirecte de la victoire de la Guerre d'indépendance américaine (voir Zysberg A. Nouvelle histoire de la France moderne. Tome 5, La monarchie des Lumières 1715-1786. Paris : Ed. du Seuil, 2002 , 552 p. (Collection : Points. Histoire, n°211, ISSN : 0768-0457)

Portrait de Choiseul par Carle Van Loo
Son domaine favori était la politique extérieure, où il incarne une vue exigeante, mais non point déraisonnable ni stérile de la fierté nationale et du « leadership » français. Il disputait à Kaunitz le titre de « cocher de l’Europe ». (Edgar Faure)
De 1745 à 1748 il est aux Pays-Bas pendant les sièges de Mons, Charleroi et Maastricht. Il atteint le rang de lieutenant général.
En 1750 il épouse Louise Honorine Crozat, fille de Louis François Crozat, marquis du Châtel (d. 1750), qui lui apporte une vaste fortune et se montre très dévouée.
Choiseul obtient la faveur de Madame de Pompadour en lui procurant des lettres que Louis XV a écrites à sa cousine Madame de Choiseul-Romanet, avec laquelle le roi eut une aventure galante.
Après avoir été brièvement bailli des Vosges, il est nommé ambassadeur à Rome en 1753, où il mène les négociations concernant les troubles provoqués par la résistance janséniste à la bulle papale Unigenitus.
Il agit avec efficacité et, en 1757, sa protectrice le fait nommer à Vienne, où on le charge de cimenter la nouvelle alliance entre la France et l’Autriche.
Sa réussite lui permet de devenir secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1758 à 1761, puis de 1766 à 1770, comme successeur de François-Joachim de Pierre de Bernis et donc de diriger la diplomatie française pendant la guerre de Sept Ans.
Il est fait alors « duc » et « pair de France ». En 1761, il négocie avec Jerónimo Grimaldi le troisième Pacte de famille Bourbon entre la France et l’Espagne.
Cette même année, il devient également secrétaire d’État à la Guerre et à la Marine, transférant le secrétariat d’État aux Affaires étrangères à son cousin Choiseul-Praslin qui posséda le domaine de Vaux-Praslin (Vaux-Le-Vicomte), où il se retira lors de la disgrâce de son puissant parent.
En 1766 il reprend les Affaires étrangères, Choiseul-Praslin prenant la Marine.
Arrivant au pouvoir alors que les esprits ont été démoralisés par les défaites de Rossbach et de Crefeld, il cherche à arrêter rapidement le conflit, signant le traité de Paris de 1763 qui transfère à la Grande-Bretagne le Canada et l’Inde mais conservant à la France les Antilles et la production du sucre.
Dans l’espoir qu’un nouveau conflit, cette fois-ci victorieux, pourra rétablir l’équilibre des puissances en Europe, il réforme avec énergie l’Armée et la Marine, et augmente le nombre de vaisseaux (grâce notamment au « don des vaisseaux »). Il investit dans les colonies des Antilles, notamment Saint-Domingue, et il achète la Corse à la république de Gênes.
En février 1766, il prend officiellement possession du Barrois et de la Lorraine au nom du roi. Sa gestion intérieure est jugée favorablement par les encyclopédistes qu’il soutient en bannissant les Jésuites.

Étienne-François de Choiseul, Madame de Brionne et l’abbé Barthélemy.
C’est une des raisons de sa chute, avec son soutien à La Chalotais, et l’opposition des parlements provinciaux à sa politique.
Ses ennemis, menés par la comtesse du Barry, maîtresse du roi, et le chancelier Maupeou, ont raison de lui. En 1770 il reçoit l’ordre de se retirer dans son château de Chanteloup près d’Amboise, où il mourut, qui fut vendu en 1786 par sa veuve au duc de Penthièvre. En 1794 le château est vidé de son mobilier par saisies révolutionnaires, puis acquis par Chaptal, dont le fils, pressé par ses créanciers, le vendit à "la Bande Noire", sorte d'association de marchands de biens et de matériaux qui le dépeça et le démolit, à l'exception des caves, des deux pavillons de l'avant-cour et de La Pagode qui, avec la forêt, fut rachetée ensuite par Louis-Philippe Ier.
Les intrigues contre lui avaient, cependant, augmenté sa popularité, laquelle était déjà grande, et durant son bannissement qui dure jusqu’en 1774 il est visité par des personnages puissants. Il apparaît alors comme un véritable chef de l’opposition. « Le duc de Choiseul, exilé à Chanteloup, y avait toute la France », observe l’abbé Morellet en 1773.
Fermant la traditionnelle perspective "traversante" entrée-avant-cour- cour d'honneur-château-jardins, il fait construire sur une colline par son architecte attitré, Louis-Denis Le Camus, une "pagode" de style chinois de sept étages dédiée "à l'Amitié", où il aurait fait graver sur des tables de marbre blanc les noms des 210 personnes de haute condition qui vinrent le visiter durant son exil.
Ses partisans n’eurent de cesse de contrecarrer toutes les tentatives de réforme, paradoxe d’un libéral à la tête d’un parti conservateur.
À l’avènement de Louis XVI, le 10 mai 1774, Choiseul espère son rappel. La mort de Louis XV et l’exil de la comtesse du Barry sont autant de circonstances favorables. Choiseul est expérimenté et populaire. De surcroit, il a été l’homme de l’alliance avec l’Autriche.
Mais en réalité, si Marie-Antoinette apprécie Choiseul et souhaite son retour, l’impératrice Marie-Thérèse se satisfait parfaitement du duc d’Aiguillon, qu’elle juge « doué de peu de génie et de talents, sans crédit et harcelé sans cesse par des factions ». Surtout, Louis XVI ne pardonne pas à Choiseul de s’être vivement opposé à son père, le Dauphin Louis-Ferdinand, à propos de l’expulsion des Jésuites en 1764, à tel point que lorsque le Dauphin mourut en 1765, le bruit courut que Choiseul l’avait fait empoisonner.
Aussi, le Roi ne rappelle-t-il pas ce dernier mais, cédant aux instances de la Reine, il met fin à son exil et lui permet de revenir à Paris. Il reparait à la Cour dès le 12 juin 1774, mais à cette date, Maurepas domine le Conseil et Vergennes occupe le secrétariat d’État aux Affaires étrangères.
Louis XVI lui réserve un accueil maussade, se bornant à lui dire : « Monsieur de Choiseul, vous avez perdu une partie de vos cheveux. » Choiseul comprend qu’il n’a plus rien à espérer et repart dès le lendemain pour Chanteloup où il meurt onze ans plus tard.

N°828
" Le duc de Choiseul avait le goût des aménagements somptueux. Ce fut un amateur d'art singulièrement averti. Son goût raffiné se manifeste dans une miniature de Van Blarenberghe, représentant (sa) chambre (...) les tableaux qui ornaient cet appartement ont été reproduits dans le "Cabinet de Choiseul" de Basan :
"L'Offrande à l'Amour" de Greuze (exposé au salon de 1769, coll. prince de Conti puis coll. Wallace), "Le Baiser envoyé" de Greuze, "La Jeune Grecque sortant du bain" par Vien, "Le Sacrifice à Priape" de Raoux, un secrétaire et une bibliothèque d'Oeben, "L'Innocence", statue de J.J.Caffieri (exposée au Salon de 1767) (...) Tous les appartements de Chanteloup sont ornés avec le même goût. Le musée de Tours conserve une grande quantité de toiles (...). Les jardins qui entouraient le palais étaient à l'unisson".
(René-Edouard André, "Documents inédits sur l'histoire du château et des jardins de Chanteloup", bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, Librairie Armand Colin, 1935, p 29 et 30 - archives pers.).
"Les achats et les ventes de mobiliers et d'objets d'art par les Choiseul ont jalonné l'histoire de la curiosité et des collections de 1764 à 1875, dont les ventes prestigieuses de 1793 et 1808 (...) le goût Choiseul a été somptueux". (Patrice de Vogué, "Mémoire d'un chef-d'oeuvre, Vaux-Le-Vicomte", 1875-2008, Imprimerie Nationale, 2008, p.44).
Ainsi, la vente du 18 février 1793 à Paris des "Tableaux précieux de feu monsieur de Choiseul-Praslin", comptait "Le Repas" de Jordaens (anc coll. Randon de Boisset), "Le ménage du Menuisier" de Rembrandt (anc. coll. Gaignat), un "Portrait de Suzanne Fourment" par Rubens..les trois furent acquis par l'expert Lebrun pour le Museum (actuel musée du Louvre), et le bouclier de parade du roi Charles IX, attribué à Étienne Deleaume (musée du Louvre), "un des chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie française du XVIème siècle".
(Michel Beurdeley, "La France à l'Encan, 1789-1799, Fribourg, office du Livre, puis Paris, Jules Tallandier, 1981, pp. 126 à 130).
Issu d’une grande famille originaire de Lorraine, il porte – comme son père – le prénom du dernier duc de Lorraine et de Bar, François III Étienne.
Fils aîné de François Joseph de Choiseul, marquis de Stainville (1700-1770), et de Françoise-Louise de Bassompierre, il prend d’abord le titre de son père lequel l’envoie faire carrière en France tandis que son cadet est destiné à servir l’Empire (le duc François III Étienne étant destiné à succéder à son beau-père l’Empereur Charles VI).
Il s’engage dans l’armée dans le régiment de Navarre, avec lequel il participe aux campagnes de Bohême en 1741 et d’Italie, notamment la bataille de Coni, pendant la guerre de Succession d'Autriche.
Choiseul possède à la fois des capacités aux affaires et de l’assiduité au travail, mais il manque de ténacité contre ses opposants. Physiquement il était petit et laid.
« Léger et frivole dans son privé jusqu’à l’effronterie, roué dans l’intrigue jusqu’au cynisme, il joignait aux grandes capacités de l’homme d’État le rayonnement d’un chef de parti, et de ce double fait il a dominé la vie politique de son temps ».
Son amoralisme dans les affaires de l’amour et du pouvoir – inextricablement enchevêtrées au long de sa carrière – ne l’empêchait pas d’avoir, à la différence de plusieurs de ses rivaux, une conception sérieuse et personnelle des tâches politiques.
Laïc et libéral – admirateur du système britannique – Bien qu'il ait souvent été considéré injustement comme n'ayant jamais eu le projet de réformer l’État (confère les Mémoires de Talleyrand). la réalité est plus complexe. Pour un homme d'Etat libéral, il est à l'origine de la modernisation des appareils de souveraineté tels que l'armée, la marine, la diplomatie afin de préparer la revanche contre l’Angleterre. De ce fait il a contribué de manière indirecte de la victoire de la Guerre d'indépendance américaine (voir Zysberg A. Nouvelle histoire de la France moderne. Tome 5, La monarchie des Lumières 1715-1786. Paris : Ed. du Seuil, 2002 , 552 p. (Collection : Points. Histoire, n°211, ISSN : 0768-0457)

Portrait de Choiseul par Carle Van Loo
Son domaine favori était la politique extérieure, où il incarne une vue exigeante, mais non point déraisonnable ni stérile de la fierté nationale et du « leadership » français. Il disputait à Kaunitz le titre de « cocher de l’Europe ». (Edgar Faure)
De 1745 à 1748 il est aux Pays-Bas pendant les sièges de Mons, Charleroi et Maastricht. Il atteint le rang de lieutenant général.
En 1750 il épouse Louise Honorine Crozat, fille de Louis François Crozat, marquis du Châtel (d. 1750), qui lui apporte une vaste fortune et se montre très dévouée.
Choiseul obtient la faveur de Madame de Pompadour en lui procurant des lettres que Louis XV a écrites à sa cousine Madame de Choiseul-Romanet, avec laquelle le roi eut une aventure galante.
Après avoir été brièvement bailli des Vosges, il est nommé ambassadeur à Rome en 1753, où il mène les négociations concernant les troubles provoqués par la résistance janséniste à la bulle papale Unigenitus.
Il agit avec efficacité et, en 1757, sa protectrice le fait nommer à Vienne, où on le charge de cimenter la nouvelle alliance entre la France et l’Autriche.
Sa réussite lui permet de devenir secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 1758 à 1761, puis de 1766 à 1770, comme successeur de François-Joachim de Pierre de Bernis et donc de diriger la diplomatie française pendant la guerre de Sept Ans.
Il est fait alors « duc » et « pair de France ». En 1761, il négocie avec Jerónimo Grimaldi le troisième Pacte de famille Bourbon entre la France et l’Espagne.
Cette même année, il devient également secrétaire d’État à la Guerre et à la Marine, transférant le secrétariat d’État aux Affaires étrangères à son cousin Choiseul-Praslin qui posséda le domaine de Vaux-Praslin (Vaux-Le-Vicomte), où il se retira lors de la disgrâce de son puissant parent.
En 1766 il reprend les Affaires étrangères, Choiseul-Praslin prenant la Marine.
Arrivant au pouvoir alors que les esprits ont été démoralisés par les défaites de Rossbach et de Crefeld, il cherche à arrêter rapidement le conflit, signant le traité de Paris de 1763 qui transfère à la Grande-Bretagne le Canada et l’Inde mais conservant à la France les Antilles et la production du sucre.
Dans l’espoir qu’un nouveau conflit, cette fois-ci victorieux, pourra rétablir l’équilibre des puissances en Europe, il réforme avec énergie l’Armée et la Marine, et augmente le nombre de vaisseaux (grâce notamment au « don des vaisseaux »). Il investit dans les colonies des Antilles, notamment Saint-Domingue, et il achète la Corse à la république de Gênes.
En février 1766, il prend officiellement possession du Barrois et de la Lorraine au nom du roi. Sa gestion intérieure est jugée favorablement par les encyclopédistes qu’il soutient en bannissant les Jésuites.

Étienne-François de Choiseul, Madame de Brionne et l’abbé Barthélemy.
C’est une des raisons de sa chute, avec son soutien à La Chalotais, et l’opposition des parlements provinciaux à sa politique.
Ses ennemis, menés par la comtesse du Barry, maîtresse du roi, et le chancelier Maupeou, ont raison de lui. En 1770 il reçoit l’ordre de se retirer dans son château de Chanteloup près d’Amboise, où il mourut, qui fut vendu en 1786 par sa veuve au duc de Penthièvre. En 1794 le château est vidé de son mobilier par saisies révolutionnaires, puis acquis par Chaptal, dont le fils, pressé par ses créanciers, le vendit à "la Bande Noire", sorte d'association de marchands de biens et de matériaux qui le dépeça et le démolit, à l'exception des caves, des deux pavillons de l'avant-cour et de La Pagode qui, avec la forêt, fut rachetée ensuite par Louis-Philippe Ier.
Les intrigues contre lui avaient, cependant, augmenté sa popularité, laquelle était déjà grande, et durant son bannissement qui dure jusqu’en 1774 il est visité par des personnages puissants. Il apparaît alors comme un véritable chef de l’opposition. « Le duc de Choiseul, exilé à Chanteloup, y avait toute la France », observe l’abbé Morellet en 1773.
Fermant la traditionnelle perspective "traversante" entrée-avant-cour- cour d'honneur-château-jardins, il fait construire sur une colline par son architecte attitré, Louis-Denis Le Camus, une "pagode" de style chinois de sept étages dédiée "à l'Amitié", où il aurait fait graver sur des tables de marbre blanc les noms des 210 personnes de haute condition qui vinrent le visiter durant son exil.
Ses partisans n’eurent de cesse de contrecarrer toutes les tentatives de réforme, paradoxe d’un libéral à la tête d’un parti conservateur.
À l’avènement de Louis XVI, le 10 mai 1774, Choiseul espère son rappel. La mort de Louis XV et l’exil de la comtesse du Barry sont autant de circonstances favorables. Choiseul est expérimenté et populaire. De surcroit, il a été l’homme de l’alliance avec l’Autriche.
Mais en réalité, si Marie-Antoinette apprécie Choiseul et souhaite son retour, l’impératrice Marie-Thérèse se satisfait parfaitement du duc d’Aiguillon, qu’elle juge « doué de peu de génie et de talents, sans crédit et harcelé sans cesse par des factions ». Surtout, Louis XVI ne pardonne pas à Choiseul de s’être vivement opposé à son père, le Dauphin Louis-Ferdinand, à propos de l’expulsion des Jésuites en 1764, à tel point que lorsque le Dauphin mourut en 1765, le bruit courut que Choiseul l’avait fait empoisonner.
Aussi, le Roi ne rappelle-t-il pas ce dernier mais, cédant aux instances de la Reine, il met fin à son exil et lui permet de revenir à Paris. Il reparait à la Cour dès le 12 juin 1774, mais à cette date, Maurepas domine le Conseil et Vergennes occupe le secrétariat d’État aux Affaires étrangères.
Louis XVI lui réserve un accueil maussade, se bornant à lui dire : « Monsieur de Choiseul, vous avez perdu une partie de vos cheveux. » Choiseul comprend qu’il n’a plus rien à espérer et repart dès le lendemain pour Chanteloup où il meurt onze ans plus tard.

N°828
" Le duc de Choiseul avait le goût des aménagements somptueux. Ce fut un amateur d'art singulièrement averti. Son goût raffiné se manifeste dans une miniature de Van Blarenberghe, représentant (sa) chambre (...) les tableaux qui ornaient cet appartement ont été reproduits dans le "Cabinet de Choiseul" de Basan :
"L'Offrande à l'Amour" de Greuze (exposé au salon de 1769, coll. prince de Conti puis coll. Wallace), "Le Baiser envoyé" de Greuze, "La Jeune Grecque sortant du bain" par Vien, "Le Sacrifice à Priape" de Raoux, un secrétaire et une bibliothèque d'Oeben, "L'Innocence", statue de J.J.Caffieri (exposée au Salon de 1767) (...) Tous les appartements de Chanteloup sont ornés avec le même goût. Le musée de Tours conserve une grande quantité de toiles (...). Les jardins qui entouraient le palais étaient à l'unisson".
(René-Edouard André, "Documents inédits sur l'histoire du château et des jardins de Chanteloup", bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, Librairie Armand Colin, 1935, p 29 et 30 - archives pers.).
"Les achats et les ventes de mobiliers et d'objets d'art par les Choiseul ont jalonné l'histoire de la curiosité et des collections de 1764 à 1875, dont les ventes prestigieuses de 1793 et 1808 (...) le goût Choiseul a été somptueux". (Patrice de Vogué, "Mémoire d'un chef-d'oeuvre, Vaux-Le-Vicomte", 1875-2008, Imprimerie Nationale, 2008, p.44).
Ainsi, la vente du 18 février 1793 à Paris des "Tableaux précieux de feu monsieur de Choiseul-Praslin", comptait "Le Repas" de Jordaens (anc coll. Randon de Boisset), "Le ménage du Menuisier" de Rembrandt (anc. coll. Gaignat), un "Portrait de Suzanne Fourment" par Rubens..les trois furent acquis par l'expert Lebrun pour le Museum (actuel musée du Louvre), et le bouclier de parade du roi Charles IX, attribué à Étienne Deleaume (musée du Louvre), "un des chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie française du XVIème siècle".
(Michel Beurdeley, "La France à l'Encan, 1789-1799, Fribourg, office du Livre, puis Paris, Jules Tallandier, 1981, pp. 126 à 130).