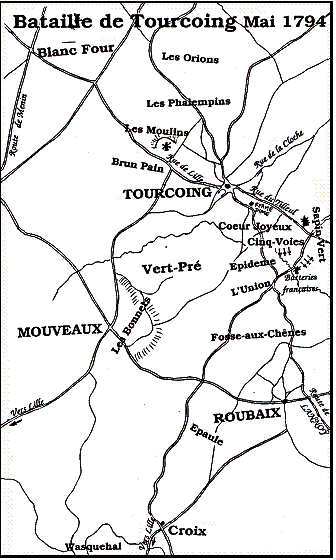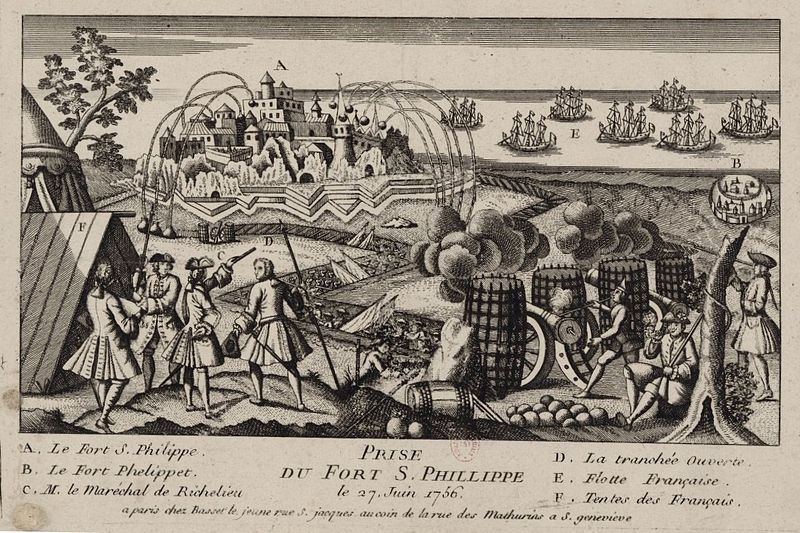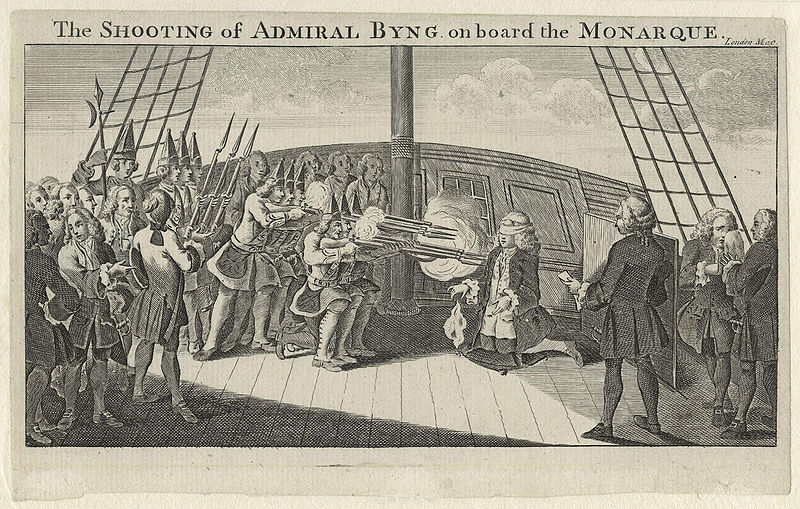À onze heures, Malborough ordonna à son armée de se déployer en bataille. À l'extrême droite, dans la direction de Folx, les bataillons et escadrons britanniques s'établirent en une double ligne près du ruisseau du Jauche. Le centre était formé par la masse des Hollandais, Allemands, Protestants suisses et infanterie écossaise – près de 30 000 hommes – faisant face à Offus et Ramillies. Face à Ramillies, le duc installa également une puissante batterie de trente pièces de 24-pounders, amenées sur places par des bœufs. D'autres batteries vinrent couronner la Petite Gette. À leur gauche, sur la large plaine entre Taviers et Ramillies – où Marlborough pressentit que se livrerait le combat décisif – Overkirk rassembla les 69 escadrons de cavaleries hollandaise et danoise, supportés par 19 bataillons d'infanterie batave et deux pièces d'artillerie.
Entre-temps, Villeroy avait modifié son dispositif. Dans Taviers sur sa droite, il plaça deux bataillons du régiment suisse de Greder, avec un détachement avancé à Franquenée, le dispositif étant protégé par les accidents du terrain traversé par la Mehaigne qui prévenait ainsi un débordement flanquant par les Alliés. Entre Taviers et Ramillies, il déploie 82 escadrons sous le commandement du général de Guiscard supportés par plusieurs brigades d'infanterie française, suisse et bavaroise. Le long de la ligne Ramillies–Offus–Autre Eglise, Villeroy positionne son infanterie wallonne et bavaroise, supportée par les 50 escadrons bavarois et wallons de l'Électeur de Bavière Maximilien II installés à l'arrière sur le plateau de Mont-Saint-André. Ramillies, Offus et Autre-Eglise furent bien garnis de troupes et mis en état de défense avec les chaussées barricadées et les murs percés de meurtrières. Villeroy installa également de puissantes batteries près de Ramillies, ces canons couvrant les approches du plateau de Jandrenouille par lesquelles l'infanterie alliée devait passer.
Marlborough nota cependant quelques faiblesses dans le dispositif français. S'il est tactiquement impératif pour Villeroy d'occuper Taviers à sa droite et Autre-Eglise à sa gauche, en procédant de cette manière, il a considérablement étiré ses forces. Plus encore, le dispositif français – concave face à l'armée alliée – permet à Marlborough de former une ligne plus ramassée, déployée sur un front plus court entre les pointes de l'arc français permettant ainsi de délivrer une poussée plus compacte et puissante. Accessoirement, ce déploiement lui offrait la possibilité de repositionner plus facilement ses unités par le jeu des lignes intérieures, un avantage tactique qui allait se révéler déterminant pour la suite de la journée. Bien que Villeroy disposait de la possibilité d'envelopper les flancs alliés déployés sur le plateau de Jandrenouille – menaçant ainsi la Coalition d'encerclement – le duc diagnostiqua de manière très pertinente que le commandement français, très prudent comme à son habitude, entendait avant tout livrer une bataille défensive le long de sa ligne.
À treize heures, les batteries donnèrent et un peu plus tard, deux colonnes alliées surgirent des extrémités de leurs lignes pour mener l'assaut contre les ailes de l'armée franco-bavaroise.
Au sud, les gardes hollandaises, menées par le colonel Wertmüller, s'avancèrent avec leurs deux canons de campagne pour s'emparer du hameau de Franquenée. La petite garnison suisse, bousculée par cet assaut soudain et abandonnée par les bataillons déployés en arrière, fut rapidement refoulée sur le village de Taviers. Taviers était une position-clé dans le dispositif franco-bavarois : il protégeait le flanc de la cavalerie du général de Guiscard exposé du côté de la plaine tout en permettant à l'infanterie française de menacer ceux de la cavalerie hollando-danoise pendant son déploiement. Les Suisses avaient à peine rejoint leurs camarades occupant le village que les gardes hollandaises l'attaquaient à son tour. Le combat dans la bourgade tourna rapidement en une furieuse mêlée à la baïonnette et à l'empoignade mais la puissance de feu supérieure des Hollandais fit pencher la balance en leur faveur. Le très expérimenté colonel de l'armée française Jean Martin de la Colonie, assistant à la scène depuis la plaine, écrira par la suite : « ce village vit l'ouverture de l'engagement et le combat là fut presque aussi meurtrier que tout le reste de la bataille » Vers quinze heures, les Suisses étaient chassés du village et repoussés dans les marécages situés derrière lui.
L'aile droite de Villeroy sombra dans le chaos et était désormais exposée et vulnérable. Avisé de la situation, de Guiscard ordonna une attaque immédiate avec 14 escadrons de dragons français stationnés à l'arrière. Deux autres bataillons du Régiment de Greder furent également engagés, mais l'attaque fut mal coordonnée et s'étiola. Le commandement coalisé envoya alors des dragons hollandais démontés dans Taviers, d'où, avec les gardes hollandaises et leur canons de campagne, ils arrosèrent les troupes françaises d'un feu de mousqueterie et de boîtes à mitraille, le colonel d'Aubigni tombant ainsi mortellement blessé à la tête de son régiment.
Alors qu'un flottement se faisait sentir dans les rangs français, les escadrons de tête de la cavalerie danoise, maintenant à l'abri de tout tir en écharpe partant des villages, furent lancés à l'attaque et tombèrent sur le flanc exposé de l'infanterie et des dragons franco-suisses. De la Colonie, avec son régiment de Grenadiers Rouges réunis à la garde de Cologne, ayant reçu l'ordre de se porter en avant depuis sa position au sud de Ramillies afin d'appuyer la contre-attaque défaillante ne put que constater le chaos en arrivant sur place : « mes troupes ne conservèrent que difficilement leur cohésion quand les Suisses et les dragons qui nous avaient précédés refluèrent sur mes bataillons dans leur fuite... Mes propres hommes virent volte-face et les accompagnèrent dans leur repli. ». De la Colonie réussit finalement à rallier quelques-uns de ses grenadiers, avec les restes des unités de dragons français et des Suisses des bataillons Greder mais il ne s'agissait là que d'une manœuvre de détail n'apportant somme toute qu'un fragile secours au flanc droit malmené de Villeroy.
 La Mehaigne est un petit affluent de la Meuse arrosant la Hesbaye.
La Mehaigne est un petit affluent de la Meuse arrosant la Hesbaye.
Tandis que se développait au sud l'affaire de Taviers, le Comte d'Orkney (en) lançait la première ligne de son contingent anglais au-delà de la Petite Gette dans une attaque appuyée contre les villages fortifiés d'Offus et d'Autre-Eglise situés devant la droite alliée. Villeroy, se postant lui-même près d'Offus, surveilla anxieusement l'avance des Redcoats, gardant à l'esprit le conseil reçu le 6 de Louis XIV lui-même : « Prêtez une attention particulière à la partie de la ligne qui subira le premier choc des troupes anglaises ». Obnubilé par cet avertissement, le commandant français commença à transférer des bataillons du centre vers sa gauche, en comblant les vides ainsi créés dans cette partie de son dispositif par des prélèvements compensatoires sur sa droite pourtant déjà affaiblie
Alors qu'ils descendaient les pentes douces de la vallée de la Petite Gette, les bataillons anglais se retrouvèrent nez à nez avec l'infanterie wallonne particulièrement disciplinée du major général de la Guiche, dépêchée vers l'avant depuis Offus. Après plusieurs salves de mousqueterie qui prélevèrent un lourd tribu dans les rangs anglais, les Wallons se retirèrent sur la ligne de crête en bon ordre. Cependant, les Anglais purent reformer leurs rangs sur la rive « française » du cours d'eau et gravir la pente de la berge en direction des bâtiments et barricades la couronnant. La vigueur de l'assaut anglais fut telle qu'il menaça de percer la ligne des villages et de déboucher sur le plateau du Mont-Saint-André au-delà. Ceci se révéla cependant potentiellement dangereux pour l'assaillant qui se serait ainsi retrouvé à la merci des escadrons de cavalerie wallons et bavarois de l'Électeur de Bavière qui, déployés sur le plateau, attendaient l'ordre de faire mouvement.
Bien que la cavalerie britannique d'Henry Lumley (en) soit parvenue à se frayer un chemin dans la zone marécageuse entourant la Petite Gette, il devint évident aux yeux de Marlborough qu'il ne pourrait disposer ici d'une cavalerie suffisante et que la bataille ne pourrait donc être gagnée sur l'aile droite alliée. En conséquence, il rappela l'attaque contre Offus et Autre-Église et pour être sûr qu'Orkney obéirait à ses ordres, Marlborough lui envoya son Quartermaster-General en personne pour les lui signifier. En dépit des protestations de son interlocuteur, Cadogan se montra inflexible et Orkney finit, de mauvaise grâce, par donner l'ordre à ses troupes de revenir sur leurs positions de départ sur les bords du plateau de Jandrenouille. Il est difficile toutefois de savoir si l'attaque d'Orkney n'était ou non qu'une feinte : selon l'historien David Chandler (en), il serait plus exact de parler de « coup de sonde » donné par Marlborough dans le but de tester les possibilités tactiques dans ce secteur du front. Néanmoins, cette attaque avortée avait servi ses desseins : Villeroy avait porté toute son attention personnelle sur cette partie du champ de bataille et distrait vers celui-ci d'importants moyens en infanterie et cavalerie qui aurait été mieux employés dans le combat décisif au sud de Ramillies
 George Hamilton, 1st Earl of Orkney (en) (1666–1737), par Martin Maingaud. Il dirigea personnellement les attaques de l'infanterie anglaise contre Offus et Autre-Eglise.
George Hamilton, 1st Earl of Orkney (en) (1666–1737), par Martin Maingaud. Il dirigea personnellement les attaques de l'infanterie anglaise contre Offus et Autre-Eglise.
Entre-temps, l'assaut contre Ramillies avait pris de l'ampleur.
Le jeune frère de Marlborough, le général d'infanterie Charles Churchill (en), envoya quatre brigades pour attaquer le village soit 12 bataillons d'infanterie hollandaise sous les ordres des major-généraux Schultz et Spaar, deux brigades de Saxons sous ceux du comte Schulenburg (en), une brigade écossaise au service des Hollandais dirigée par le second duc d'Argyle (en) et une brigade de protestants suisses. Les 20 bataillons français et bavarois occupant Ramillies, supportés par des dragons irlandais et une petite brigade de Gardes de Cologne et bavaroises, sous le commandement du marquis de Maffei (en), opposèrent une défense résolue, repoussant même d'emblée les assaillants en leur infligeant de lourdes pertes.
Voyant Schultz et Spaar faiblir, Marlborough ordonna à la seconde ligne d'Orkney - les bataillons danois et anglais qui n'avaient pas pris part à l'assaut contre Offus et Autre-Église - de faire mouvement vers le sud en direction de Ramillies. Profitant d'un léger repli du terrain dérobant ses troupes aux vues de l'ennemi, leur commandant, le brigadier-général van Pallandt, ordonna de laisser les étendards déployés sur les bords du plateau de Jandrenouille pour faire croire aux Français qu'elles n'avaient pas quitté leur position initiale. Ceux-ci restant dans l'expectative quant à l'importance et aux intentions des forces déployées face à eux sur l'autre berge de la Petite Gette, Marlborough lança tous ses moyens contre Ramillies et la plaine au sud. Villeroy continuait entretemps à diriger plus de réserves d'infanterie dans la direction opposée, vers son aile gauche, ne percevant que très lentement et tardivement la subtile manœuvre de changement d'aile de son adversaire
Vers 15 heures 30, Overkirk fait avancer la masse de ses escadrons sur la plaine en appui de l'attaque de l'infanterie sur Ramillies. Les escadrons disciplinés des Alliés - 48 Hollandais supportés sur leur gauche par 21 Danois - avancèrent à allure modérée vers l'ennemi, en prenant soin ainsi de ne pas fatiguer prématurément leurs montures, avant de se lancer au trot pour gagner l'élan nécessaire à leur charge. Le marquis de Feuquières, décrivant la scène, écrira après la bataille : « ils avancèrent en quatre lignes... En s'approchant, ils avancèrent leurs deuxième et quatrième lignes dans les intervalles des première et troisième lignes, de sorte qu'en approchant sur nous, ils formaient un seul front continu, sans espaces intermédiaires »
Le choc initial fut favorable aux escadrons néerlandais et danois. Le déséquilibre des forces - aggravé par Villeroy qui continuait à vider les rangs de son infanterie pour renforcer son flanc gauche - a permis aux Alliés de rejeter la première ligne de cavalerie française sur ses escadrons de deuxième ligne. Cette dernière se retrouva à son tour mise sous sévère pression pour être finalement elle aussi refoulée sur la troisième et les quelques bataillons qui restaient sur la plaine. Mais ces cavaliers français comptaient parmi l'élite de l'armée de Louis XIV - la Maison du Roi - appuyés par quatre escadrons de cuirassiers d'élite bavarois. Bien dirigée par de Guiscard, la cavalerie française se rallia, refoulant les escadrons alliés par quelques contre-attaques locales victorieuses. Sur le flanc droit d'Overkirk, près de Ramillies, dix de ses escadrons rompirent soudain les rangs et furent dispersés, courant tête baissée vers l'arrière pour retrouver leur ordre et laissant le flanc gauche de l'attaque des Alliés sur Ramillies dangereusement exposé. Malgré l'absence de soutien d'infanterie, de Guiscard jeta ses cavaliers en avant en une tentative de diviser l'armée alliée en deux. Une crise menaçait le centre allié mais Marlborough, bien placé, réalisa rapidement la situation. Le commandant allié rappela dès lors la cavalerie de son aile droite pour renforcer son centre, ne laissant que les escadrons anglais en appui d'Orkney. Sous couvert du nuage de fumées et exploitant adroitement un terrain favorable, ce redéploiement passe inaperçu aux yeux de Villeroy, qui ne fait aucune tentative de transfert de l'un de ses 50 escadrons inutilisés.
En attendant l'arrivée des renforts frais, Marlborough se jeta lui-même dans la mêlée, ralliant une partie de la cavalerie hollandaise qui reculait en désordre. Mais son implication personnelle mena presque à sa perte. Quelques cavaliers français, en reconnaissant le duc, s'avancèrent dans sa direction. Le cheval de Marlborough chuta et le duc fut jeté à terre - « Milord Marlborough fut culbuté », écrira plus tard Orkney. Ce fut un moment critique de la bataille : « Le major-général Murray ... le voyant tomber, marcha en toute hâte avec deux bataillons suisses pour le sauver et arrêter l'ennemi, qui bousculèrent tout sur leur chemin » se souviendra plus tard un témoin oculaire. Fort heureusement, le tout nouvel aide de camp de Marlborough, Robert, 3ème vicomte Molesworth, arriva à la rescousse au galop, hissa le duc sur son cheval et réussi à l'évacuer avant que la troupe disciplinée de Murray ne rejette les cavaliers français le poursuivant. Après une courte pause, l'écuyer de Marlborough, le colonel Bringfield (ou Bingfield), lui amena un cheval de rechange, mais tout en aidant le duc à se remettre en selle, le malheureux Bringfield fut frappé par un boulet de canon qui lui arracha la tête. Une anecdote raconte que le boulet a filé entre les jambes du capitaine-général avant de frapper l'infortuné colonel, dont le corps est tombé aux pieds de Marlborough.
Néanmoins, le danger était passé, ce qui permit au duc d'assister au déploiement des renforts de cavalerie arrivant de son flanc droit - un dangereux changement dont Villeroy resta parfaitement inconscient.
 Le Duc de Marlborough à la bataille de Ramillies.
Le Duc de Marlborough à la bataille de Ramillies.
Il était environ 16 heures 30, et les deux armées étaient étroitement au contact sur les six kilomètres de front, entre les escarmouches dans les marais dans le sud, le combat de cavalerie sur la vaste plaine, la lutte acharnée pour Ramillies au centre et autour des hameaux d'Offus et Autre-Eglise au nord où Orkney et de la Guiche se faisant face de part et d'autre de la Petite Gette étaient prêts à reprendre les hostilités.
L'arrivée des escadrons de renfort commençait à faire pencher la balance en faveur des Alliés. La fatigue, le nombre croissant des pertes et l'infériorité numérique des escadrons de Guiscard combattant dans la plaine commençaient à peser. Après de vains efforts pour tenir ou reprendre Franquenée et Taviers, le flanc droit de Guiscard était dangereusement exposé et une brèche fatale avait été ouverte sur la droite de la ligne française. Tirant avantage de celle-ci, la cavalerie danoise de Wurtemberg se porta vers l'avant pour tenter de percer le flanc de la Maison du Roi, occupée à essayer de contenir les Hollandais. Balayant tout sur leur passage sans presque rencontrer de résistance, les 21 escadrons danois se reformèrent derrière les rangs français près du Tumulus d'Hottomont, faisant face au nord vers le plateau de Mont-Saint-André en direction du flanc maintenant exposé de l'armée de Villeroy.
Les derniers renforts alliés pour le duel de cavalerie étant enfin en place, la supériorité de Marlborough sur sa gauche ne pouvait plus maintenant être contestée et les évolutions rapides et inspirées de son plan de bataille en faisait indéniablement le maître de la lice. Villeroy tente alors, mais beaucoup trop tard, de redéployer ses 50 escadrons inutilisés, mais une tentative désespérée pour former une ligne de bataille faisant face au sud, entre Offus et le Mont-Saint-André, s'empêtre dans les bagages et les tentes du camp français négligemment laissés là après le déploiement initial. Le commandant allié ordonna à sa cavalerie de se porter en avant contre la cavalerie franco-bavaroise maintenant surclassée numériquement. Le flanc droit de de Guiscard, sans un soutien d'infanterie adéquat, ne peut plus résister à l'assaut et, tournant bride vers le nord, ses cavaliers prennent la fuite dans un complet désordre. Même les escadrons que Villeroy est en train de rassembler derrière Ramillies ne peuvent résister à l'attaque. « Nous n'avions pas parcouru quarante yards en retraite quand les mots « Sauve qui peut » coururent à travers la plus grande partie, sinon toute l'armée, et tournèrent tout à la confusion » raconta le capitaine Peter Drake, mercenaire irlandais au service de la France.
Dans Ramillies, l'infanterie alliée, maintenant renforcée par les troupes anglaises ramenées du nord, a enfin percé. Le Régiment de Picardie a tenu bon mais a été pris en tenaille entre le régiment hollando-écossais du colonel Borthwick et les renforts anglais. Borthwick a été tué de même que Charles O'Brien, vicomte irlandais de Clare au service de la France, tombé à la tête de son régiment. Le marquis de Maffei tenta une dernière résistance à la tête des Gardes de Bavière et de Cologne mais en vain. Remarquant un flot de cavaliers venant rapidement du sud, il raconta par la suite : « Je suis allé vers le plus proche de ces escadrons pour donner mes ordres à ses officiers, mais au lieu d'être écouté, [je fus] immédiatement entouré et pressé de demander merci ».
 Vue actuelle sur le tumulus d'Hottomont et la plaine qui l'entoure, théâtre du combat de cavalerie qui sera l'évènement majeur de la bataille.
Vue actuelle sur le tumulus d'Hottomont et la plaine qui l'entoure, théâtre du combat de cavalerie qui sera l'évènement majeur de la bataille.
Les routes menant vers le nord et l'ouest étaient maintenant encombrées de fuyards. Orkney renvoya ses troupes anglaises au-delà de la Petite Gette pour un nouvel assaut contre Offus où l'infanterie de la Guiche avait commencé à sombrer dans la confusion. À la droite de l'infanterie, les Scots Greys de Lord John Hay ont également franchi la rivière pour charger le régiment du Roi dans Autre-Église. « Nos dragons, poussant dans le village ... ont fait un terrible carnage à l'ennemi » écrira par la suite un officier anglais. Les grenadiers à cheval bavarois et les Gardes de l'Électeur reculent pour protéger celui-ci et Villeroy mais sont dispersés par la cavalerie de Lumley. Coincés dans la masse des fuyards abandonnant le champ de bataille, les commandants français et bavarois échappent de justesse à la capture par le général Wood Cornelius, qui, ignorant tout de leur identité, dut se contenter de la capture de deux lieutenants-généraux de Bavière. Plus au sud, les restes de la brigade de la Colonie se dirigent dans la direction opposée, vers la citadelle de Namur, tenue par les Français.
La retraite tourne à la déroute. Les commandants alliés mènent personnellement leurs troupes à la poursuite de l'ennemi vaincu, ne lui laissant aucune chance de récupérer. L'infanterie alliée ne peut bientôt plus suivre, sa cavalerie la laissant au large dans la nuit tombante pour se précipiter sur les points de passage de la Dyle. À la fin, cependant, Marlborough met un terme à la poursuite, peu après minuit, près de Meldert à 12 kilomètres du champ de bataille[66]. « C'était vraiment un spectacle affligeant de voir les tristes restes de cette puissante armée réduite à une poignée » constatera un capitaine anglais.
Ayant manifestement fait preuve d'une mésestimation coupable des mouvements et intentions de son adversaire et ensuite de manque de sang-froid en se laissant déborder par les évènements, le vaincu de Ramillies ne trouva aucune grâce aux yeux des mémorialistes du temps ni des historiens militaires français postérieurs. « Son trop de confiance en ses propres lumières fut plus que jamais funeste à la France » écrira Voltaire dans son Siècle de Louis XIV. « Il eût pu éviter la bataille. Les officiers généraux lui conseillaient ce parti ; mais le désir aveugle de la gloire l'emporta. Il fit, à ce que l'on prétend, la disposition de manière qu'il n'y ait pas un homme d'expérience qui ne prévit le mauvais succès. Des troupes de recrue, ni disciplinées ni complètes étaient au centre : il laissa les bagages entre les lignes de son armée ; il posta sa gauche derrière un marais, comme s'il eût voulu l'empêcher d'aller à l'ennemi. ». S'il admet plus loin que « l'histoire est en partie le récit des opinions des hommes », la charge acerbe, fondée sur une ré-interprétation a posteriori, de Voltaire n'en paraît pas moins excessive, Théophile Lavallée, faisant sienne l'opinion de l'illustre polémiste et philosophe rajoutant : « il prit des dispositions si mauvaises, qu'il semblait chercher une défaite... ». « Le roi n'avoit rien tant recommandé au Maréchal de Villeroy que de ne rien oublier pour ouvrir la campagne par une bataille. » temporise Saint-Simon. « Le génie court et superbe de Villeroy se piqua de ces ordres si réitérés. Il se figura que le roi doutoit de son courage puisqu'il jugeoit nécessaire de l'aiguillonner si fort ; il résolut de tout hasarder pour le satisfaire, et lui montrer qu'il ne méritoit pas de si durs soupçons. ». Mais, selon ce dernier, Villeroy commit l'erreur de précipiter les choses sans attendre les renforts de Marsin, comme il le lui avait été recommandé par les ordres écrits pressants du souverain, ses pairs lui reprochant par ailleurs le choix d'un mauvais champ de bataille.
Le nombre total des victimes françaises n'a pu être fixé avec précision, si complet a été l'effondrement de l'armée franco-bavaroise ce jour-là. David Chandler dans ses ouvrages Marlborough as Military Commander et A Guide to the Battlefields of Europe donne pour décompte des victimes françaises les chiffres de 12 000 morts et blessés ainsi que quelque 7 000 prisonniers. James Falkner, dans Ramillies 1706: Year of Miracles, donne également le chiffre de 12 000 morts et blessés mais fait état de 10 000 prisonniers. The Collins Encyclopaedia of Military History, sous la plume de Dupuy, établit les pertes de Villeroy à 8 000 hommes morts et blessés, avec 7 000 autres capturés. Les mémoires de John Millner – « Compendious Journal » (1733) – sont plus précises en citant 12 087 tués ou blessés et 9 729 prisonniers. Dans son Marlborough..., Correlli Barnett (en) avance des chiffres totaux de pertes aussi élevés que 30 000 hommes - 15 000 morts et blessés et 15 000 captifs. Trevelyan estime les pertes de Villeroy à 13 000, mais il ajoute que « les désertions pourraient avoir doublé ce nombre ». La Colonie ne donne aucun chiffre dans ses Chroniques d'un vieux troupier mais Saint-Simon dans ses Mémoires fait état de 4 000 tués, ajoutant que « de nombreux autres ont été blessés et de nombreux personnages importants ont été faits prisonniers », tandis que Voltaire dans son Histoire du Siècle de Louis XIV écrit : « les Français ont perdu là vingt mille hommes ».
Les débris de l'armée de Villeroy étaient totalement démoralisés, le déséquilibre dans la balance des pertes subies démontrant plus qu'amplement le désastre connu par l'armée de Louis XIV. Par ailleurs, des centaines de soldats français avaient fui, la plupart d'ailleurs ne rejoignant plus leurs unités par la suite. Villeroy avait également perdu 52 pièces d'artillerie et tout son matériel de pontage du génie. Selon les mots mêmes du maréchal Villars, la défaite française à Ramillies fut « la plus honteuse, la plus humiliante et la plus désastreuse des déroutes ».
 La citadelle de Namur que la France réussit à conserver à l'issue de la désastreuse campagne de 1706.
La citadelle de Namur que la France réussit à conserver à l'issue de la désastreuse campagne de 1706.
« Villeroy perdit la tête: il ne s'arrêta ni sur la Dyle, ni sur la Senne, ni sur la Dender, ni sur l'Escaut; il évacua Louvain, Bruxelles, Alost, Gand, Bruges, tout le Brabant, toute la Flandre; enfin il se retira sur Menin et jeta les débris de son armée dans quelques places. L'ennemi n'eut qu'à marcher en avant, étonné de ce vertige; il entra à Bruxelles, il entra à Gand; il prit Anvers, Ostende, Menin, Dendermonde, Ath. Il ne resta d'autres grandes places aux Français que Mons et Namur »
— Théophile Lavallée, Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1830
Après la victoire des Alliés à Ramillies, les villes et places belges tombèrent les unes après les autres entre leurs mains : Louvain tomba le 25 mai 1706 et trois jours plus tard, ils entraient à Bruxelles, alors capitale des Pays-Bas espagnols. Marlborough réalisa la grande opportunité que lui offrait sa victoire : « Nous avons maintenant tout l'été devant nous et avec la bénédiction de Dieu, je ferai le meilleur usage de celui-ci » écrit le duc à Robert Harley (en) depuis Bruxelles. Malines, Lierre, Gand, Alost, Damme, Audenarde,Bruges, et Anvers le 6 juin, toutes passent ensuite aux mains de l'armée victorieuse de Marlborough et, comme Bruxelles, se choisissent le candidat autrichien pour le trône d'Espagne, l'archiduc Charles, pour souverain. Villeroy est impuissant à arrêter le processus d'effondrement. Lorsque Louis XIV apprend la catastrophe, il rappele le maréchal de Vendôme du nord de l'Italie pour prendre le commandement dans les Flandres, mais il faudra des semaines avant que celui-ci ne change effectivement de mains.
La nouvelle du triomphe des Alliés se propageant, les contingents prussiens, hessois et hanovriens, longtemps retenus par leurs maîtres respectifs, se joignirent avec empressement à la poursuite des forces françaises et bavaroises en déroute, entraînant des commentaires assez désabusés de Marlborough. Entre-temps, Overkirk s'était emparé du port d'Ostende le 4 juillet, ouvrant ainsi un accès direct à la Manche pour les communications et l'approvisionnement, mais les Alliés marquèrent le pas devant Termonde dont le gouverneur, le marquis de Valée (en), résistait obstinément. Ce n'est que plus tard, quand Cadogan et Churchill prirent les choses en main, que sa résistance fléchît.
Louis-Joseph de Vendôme prit officiellement le commandement en Flandre le 4 août. Villeroy, son malchanceux et malheureux prédécesseur, ne recevra plus jamais de commandement important, déplorant amèrement : « Je ne peux compter un jour heureux dans ma vie sauf celui de ma mort ». Louis XIV se montra cependant indulgent, consolant son vieil ami avec des paroles aimables : « À notre âge, maréchal, il ne faut plus s'attendre à bonne fortune ». Pendant ce temps, Marlborough investit la formidable forteresse de Menin qui, après un siège coûteux, capitula le 22 août. Termonde a finalement succombé le 6 septembre, suivie par Ath - la dernière conquête de 1706 - le 2 octobre. Au moment où se clôt la campagne de Ramillies, Marlborough avait privé la France de la plus grande partie des Pays-Bas espagnols (correspondants grosso modo à l'actuelle Belgique) située à l'ouest de la Meuse et au nord de la Sambre - un incomparable triomphe opérationnel pour le duc anglais.
Pendant que se déroulait cette funeste campagne des Flandres, sur le Haut-Rhin, Villars avait été contraint à la défensive à mesure que ses bataillons étaient envoyés un par un au nord pour renforcer les forces françaises engagées contre Marlborough, le privant ainsi de toute possibilité de reprendre Landau. D'autres bonnes nouvelles parvinrent aux Coalisés d'Italie du Nord où, le 7 septembre, le prince Eugène avait mis en déroute une armée française devant Turin, chassant les forces franco-espagnoles de la région. Seule l'Espagne apporta quelques heureuses nouvelles à Louis XIV, António Luís de Sousa (en) ayant été forcé à la retraite hors de Madrid vers Valence, ce qui avait permis à Philippe V de rentrer dans sa capitale le 4 octobre. Dans l'ensemble, cependant, la situation avait considérablement empiré et Louis XIV commença à chercher le moyen de mettre fin à ce qui était en train de devenir une guerre ruineuse pour la France. Pour la reine Anne également, la campagne de Ramillies avait une importance capitale en permettant d'espérer la paix. Mais des fissures dans l'unité des Alliés allaient permettre au roi de France de compenser certains des revers majeurs subis à la suite de Turin et de Ramillies.
 Le Duc de Marlborough se voit présenter les étendards capturés pendant la bataille.
Le Duc de Marlborough se voit présenter les étendards capturés pendant la bataille.
Suite à cette défaite Maximilien-Emmanuel de Bavière, gouverneur des Pays-Bas espagnols, est contraint d'abandonner définitivement Bruxelles et de se réfugier à Mons, puis en France.
La question politique immédiate qui se posait donc aux Alliés maintenant était de savoir comment régler le sort des Pays-Bas espagnols, un sujet sur lequel les Autrichiens et les Hollandais étaient diamétralement en conflit. L'empereur Joseph Ier, parlant au nom de son jeune frère le roi Charles III qui se trouvait à ce moment en Espagne, fit valoir que le Brabant et la Flandre reconquis devaient être placés immédiatement sous l'autorité d'un gouverneur nommé par lui-même. Mais les Hollandais, qui avaient fourni la majeure partie des troupes et des fonds pour assurer la victoire - les Autrichiens n'ayant offert ni l'un ni l'autre, réclamèrent le gouvernement de la région jusqu'à la fin de la guerre et, une fois la paix revenue, le droit de maintenir des garnisons dans la ligne des forteresses plus fortes que celles déployées précédemment et qui n'avaient pu s'opposer efficacement aux forces de Louis XIV en 1701.
Marlborough joua les médiateurs entre les deux parties, mais en favorisant la position hollandaise. Pour influencer l'opinion du duc, l'empereur Joseph Ier lui offrit le poste de gouverneur des Pays-Bas espagnols. Il s'agissait d'une offre alléchante, mais au nom de l'unité des Alliés, Marlborough la refusa[88] En fin de compte, l'Angleterre et les Provinces-Unies assurèrent conjointement le contrôle du territoire nouvellement acquis pour la durée de la guerre, après laquelle il devait être remis sous l'autorité directe de Charles III, sous la réserve d'une présence militaire hollandaise dont les modalités devaient encore être précisée .
Après Höchstadt et Ramillies, le duc de Marlborough, assisté par les troupes autrichiennes du Prince Eugène, remportera la victoire d'Audernarde en 1708 sur le duc de Vendôme, et livrera l'année suivante la bataille très disputée de Malplaquet contre le maréchal de Villars.
Le duc de Marlborough étant devenu la bête noire des Français, ceux-ci inventeront la chanson bien connue « Marlbrough s'en va-t-en guerre,.. » afin de le dé-diaboliser.
Un monument dans l'aile nord de l'Abbaye de Westminster commémore la mort tragique du colonel Bingfield.
Cette bataille fut un modèle de stratégie dont, dit-on, Napoléon s'inspira à plusieurs reprises.
La victoire à Ramillies eut un grand retentissement en Grande-Bretagne : différents navires de la Royal Navy reçurent ainsi le nom de Ramillies comme nom de baptême. Par la suite, lors de la construction de la voie de chemin de fer entre Tamines et Landen en 1862, l'entrepreneur écossais E. Preston insista pour que la ligne passe en partie sur le territoire de la commune afin d'y construire une gare qui portera par la suite de nom « la Croix de Hesbaye ».
Le champ de bataille de Ramillies constitue, avec celui de Waterloo, un des sites militaires historiques majeurs de Belgique, riche par ailleurs de vestiges gallo-romains (chaussée romaine, tumulus) et il est aussi une étape importante sur les voies migratoires ornithologiques. Menacé par divers projets - dont notamment l'implantation d'un parc d'éoliennes - il fait l'objet de diverses actions en vue de son classement éventuel